Définition
Une réponse spontanée se produit de toi-même. C’est une réponse libre et sans contraintes. Tu réponds à la question demandée sans arrière-pensée pour la durée indiquée.
Journal
Tout au long de ce cours, il te sera demandé de répondre à des questions de réflexion dans ton journal. Tu peux utiliser un journal électronique ou en écrire un à la main.
Réponse spontanée
Parfois, on te demandera de répondre spontanément à des questions. De plus, tu compléteras plusieurs réponses spontanées dans ton journal ou à l’orale.
Il serait à toi de choisir dix réponses spontanées que tu as complétées et les soumettre pour une rétroaction et une note à la fin du cours. Choisis avec soin ! Cette évaluation vaut 10 % de ta note finale.
Pour des réponses orales, tu peux les écrire dans ton journal pendant le cours et ensuite les enregistrer pour les soumettre pour la rétroaction. Tu peux enregistrer sous la forme d’un vlogue (blogue vidéo) ou d’un enregistrement sonore ! Tu peux utiliser ton téléphone cellulaire ou un autre appareil électronique de ton choix. Il existe de nombreux sites d'enregistrement sonore sur l’internet comme « Online Voice Recorder »(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre). Il existe de nombreuses applications gratuites pour l'enregistrement de ta voix. C'est à toi de choisir la méthode que tu utilises pour enregistrer tes réflexions. Accorde-toi suffisamment de temps pour t’entraîner à utiliser ces méthodes avant de soumettre ton travail final à la fin de l’unité 3 pour une rétroaction et plus tard pour une note.

Cahier de notes
Parfois, on te demandera de répondre à des questions en faisant des réflexions écrites dans ton cahier et en tenant un cahier de notes. Le cahier pourrait être électronique ou écrit à la main.

Sois créatif ! Ces réponses sont spontanées même qu’elles sont orales ou écrites. Sois organisé ! Tu en auras besoin plus tard dans ce cours et ils seront évaluées. Tres notes du cours seront utiles pour l'étude dans les activités culminantes.
Dans le cadre de cette activité, tu développeras des stratégies pour lire efficacement un document officiel. Un document officiel est un texte qui a une importance particulière pour un ou plusieurs individus. Par exemple, lorsque tu auras terminé et réussi ce cours, le ILC te remettra un document officiel certifiant que tu as bien obtenu ce crédit. Un autre exemple de document officiel est une convention collective qui concerne tous les travailleurs et travailleuses syndiqués d’un certain milieu de travail ou un texte de loi qui concerne une autre tranche de la population.
Définition
Convention collective : un contrat signé entre l’administration (les employeurs) et le syndicat, un groupe d’employés représentant les intérêts des employés.
Syndiqués : employés dont les intérêts professionnels sont défendus par un syndicat devant les employeurs.
Les documents que tu liras dans cette activité ont tout rapport avec le monde du travail. La première partie est sur la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario. Tu en apprendras davantage sur ce que les employeurs sont tenus de faire par la loi pour assurer un milieu de travail sécuritaire pour leurs employés.
Pour la deuxième partie, tu analyseras le code de conduite (aussi un document législatif) d’un ordre professionnel de ton choix. Tu en apprendras davantage sur les devoirs et les responsabilités associées à une profession ou un métier en particulier (avocats, agents correctionnels, etc.).
Partie 1 : Lecture et analyse d’une loi
Le document officiel que tu analyseras ici est la Loi sur la santé et la sécurité au travail(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre) de l’Ontario. Ton analyse sera divisée en trois étapes:
- la prélecture,
- la lecture et
- la post-lecture.
Il est important de faire toutes les étapes pour apprendre à lire et à comprendre ce genre de documents officiels.

Pour chacune des trois étapes, réponds aux questions proposées. Lorsque tu as fini, vérifie ton travail à l’aide des réponses suggérées, en les comparant avec les tiennes.
Après avoir vérifié tes réponses, pose-toi les questions de réflexion suivantes. Tu peux réfléchir davantage dans ton cahier de notes.
Autocorrection et réflexion
Ceci est une autocorrection, qui t’aidera à :
- évaluer ton travail;
- déterminer comment tu progresses dans ton apprentissage, ce qu’il te reste à accomplir et la manière d’y parvenir.
Tu recevras une rétroaction par ordinateur/des réponses suggérées que tu compareras avec tes réponses.
Après avoir vérifié tes réponses, pose-toi les questions de réflexion suivantes :
- Je dois améliorer ma compréhension de certains concepts : Quels sont-ils ?
- Quels sont mes points forts ?
- Quelles sont les mesures à prendre pour garantir une bonne compréhension de tous les concepts ?
- Quelles mesures devrais-je prendre pour m’améliorer et m’épanouir en tant qu’étudiant ou étudiante ?
Étape 1 : La prélecture
1.1 Questions préparatoires
| Homophone | Définition |
|---|---|
|
a. Mon but : Pourquoi je fais cette lecture ? |
Pour comprendre le texte et bien répondre aux questions |
|
b. Mon intention : Qu’est-ce que je veux faire ? |
|
|
c. Mes connaissances : Qu’est-ce que je connais déjà sur le sujet ? |
Je sais qu’un _______ sert à donner des renseignements sur la loi pour guider les citoyens et les avocats sur le code de conduite. |
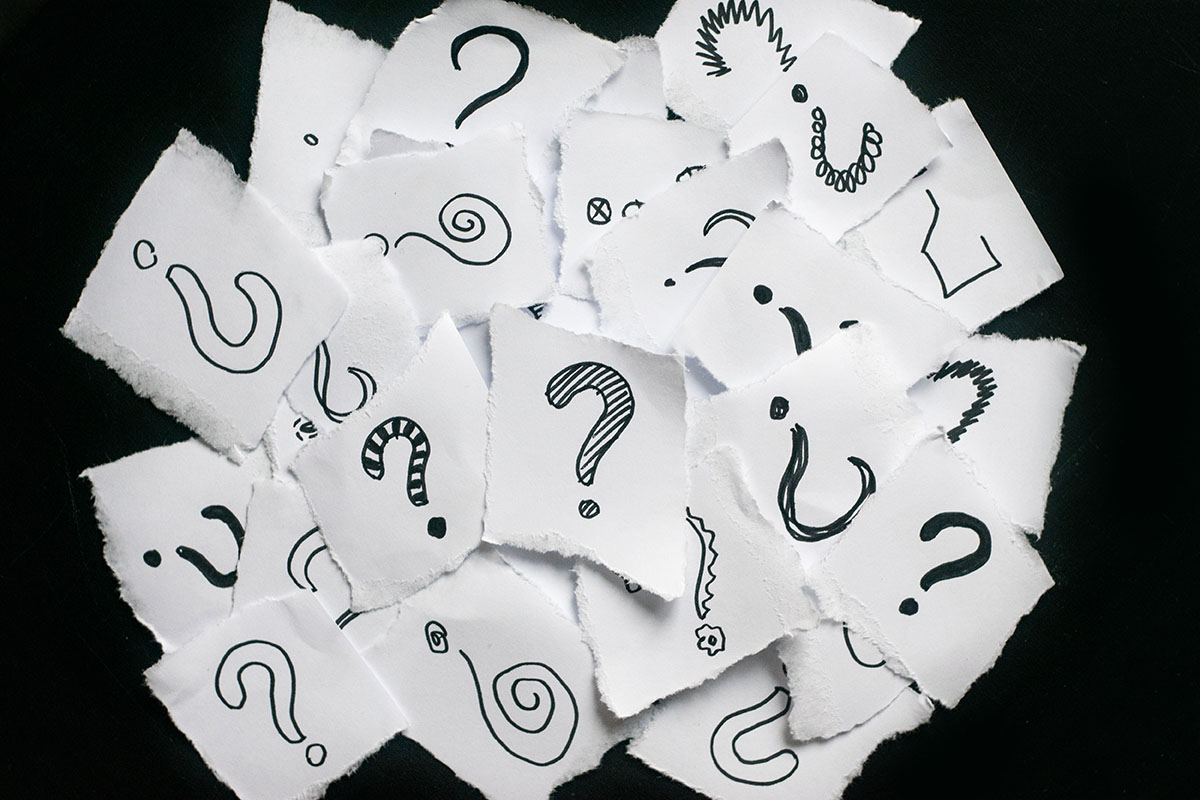
1.2 Le survol du texte
Définition
Survol: lecture d’un texte en diagonale, c’est-à-dire en ne repérant que les sous-titres, les mots en gras ou en italiques et les autres points de repère qui pourraient révéler le contenu du texte.
Quels renseignements me sont donnés dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre) en regardant uniquement la table des matières ?
Pour répondre aux questions sur cette loi, tu peux consulter le fichier ci-joint.
a. Quel est le titre du document ?
Loi sur la santé et la sécurité au travail L.R.O. 1990, chap. O.1
b. Quels sont les titres des différentes parties du texte ?
10 parties:
1.CHAMP D’APPLICATION
2.APPLICATION
2.1. CONSEIL DE LA PRÉVENTION, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PRÉVENTION ET ENTITÉ DÉSIGNÉE
3. DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES
3.01. VIOLENCE ET HARCÈLEMENT
3.1. CODES DE PRATIQUE
4. SUBSTANCES TOXIQUES
5. DROIT DE REFUSER OU D’ARRÊTER DE TRAVAILLER EN CAS DE DANGER POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ
6. INTERDICTION À L’EMPLOYEUR D’USER DE REPRÉSAILLES
7. AVIS
8. EXÉCUTION DE LA LOI
9. INFRACTIONS ET PEINES et
10. RÈGLEMENTS
c. Comment les différentes parties sont-elles organisées ou regroupées ? Sont-elles placées en ordre logique ?
- Certaines sont regroupées à l’intérieur d’une même catégorie comme la partie 3.
- Il est logique que «champs d’application» soit au tout début, car on y explique qui est concerné par cette loi (résidences privées, enseignants, etc.).
- Il est aussi logique que la partie 5 soit placée avant la partie 6, car 6 (l’interdiction à l’employeur de punir l’employé qui refuse de travailler en cas de danger) est une conséquence possible de 5 (le droit de refuser ou d’arrêter de travailler en cas de danger).
d. Y a-t-il des outils de navigation (onglets, hyperliens) ?
Oui, on peut accéder à toutes les parties du texte à partir de la table des matières, car chaque sous-partie a un numéro à gauche (4, 4.1, 5, etc.) qui est un hyperlien vers l’article (qui se trouve en dessous de la table des matières, dans le même document).
1.3 Le survol d’une partie du texte
Lis en diagonale la Partie III du texte de loi qui s’intitule: « DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES »
Mais avant de survoler cette partie, familiarise-toi avec les différentes divisions d’un texte de loi dans l’atelier suivant !
Atelier : Les différentes divisions d’un texte de loi
Voici les différentes divisions d’un texte de loi en ordre d’importance ou de grandeur:
- partie: désignée par un chiffre romain : I, II, III, IV, V, etc.
- article: désigné par un numéro sans parenthèses : 22.6, 22.7, etc.
- paragraphe: désigné par un chiffre entre parenthèses : (1), (2), (3), etc.
- alinéa: désigné par une lettre suivie d’une parenthèse : a), b), c), d), etc.
- sous-alinéa: désigné par un chiffre romain en minuscule et entre parenthèses : (i), (ii), (iii), (iv), etc.
Lis
Pour mieux comprendre la structure des textes de loi, lis cet article : « Divisions et subdivisions des textes de loi »()
Exercice
Identifie toutes les divisions d’un texte de loi dans les exemples suivants qui proviennent de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Quand tu auras fini, vérifie tes réponses.
Exemple 1
| Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1 | Division |
|---|---|
|
Idem (3) Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu du paragraphe (2) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2016, chap. 37, annexe 16, art. 2. |
paragraphe (3) |
|
Publication 7.6.5 (1) Le directeur général de la prévention peut publier ou autrement mettre à la disposition du public des renseignements sur les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités en vertu du paragraphe 7.6.1 (1) et les employeurs qui ont obtenu la reconnaissance en vertu du paragraphe 7.6.2 (1), notamment les noms des systèmes et des employeurs. 2016, chap. 37, annexe 16, art. 2. |
article 7.6.5 paragraphe (1) |
|
Délégation 7.7 Le directeur général de la prévention peut, par écrit, déléguer à une personne, y compris à une personne qui ne relève pas du ministère, les pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les paragraphes 7.1 (2) et 7.2 (2), les articles 7.4 et 7.5, l’alinéa 7.6 (1) b), les paragraphes 7.6 (5) et (6), 7.6.1 (1) et 7.6.2 (1), les articles 7.6.3 et 7.6.4 et le paragraphe 7.6.5 (1), sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences précisées dans l’acte de délégation. 2016, chap. 37, annexe 16, art. 3; 2019, chap. 9, annexe 10, art. 2. |
paragraphe (3) |
|
Sélection obligatoire d’un délégué à la santé et à la sécurité 8 (1) Sur un chantier ou dans un autre lieu de travail pour lesquels l’article 9 ne prévoit pas de comité, mais où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq, le constructeur ou l’employeur fait choisir par les travailleurs au moins un délégué à la santé et à la sécurité parmi les travailleurs du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 8 (1). |
article 8 paragraphe (1) |
|
Arrêté relatif à la nomination de délégués (2) Si, pour un lieu de travail, le paragraphe (1) ne prévoit pas de délégué à la santé et à la sécurité et que l’article 9 ne prévoit pas de comité, le ministre peut, par arrêté, enjoindre au constructeur ou à l’employeur de faire choisir par les travailleurs un ou plusieurs délégués à la santé et à la sécurité parmi les travailleurs du lieu de travail ou d’une partie de celui-ci qui n’exercent pas de fonctions de direction. L’arrêté peut préciser les qualités que ces délégués doivent posséder. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 8 (2). |
paragraphe (2) |
Exemple 2
| Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1 | Division |
|---|---|
|
Idem (16) S’il existe parmi les membres représentant le constructeur ou l’employeur plus d’un membre agréé, le constructeur ou l’employeur désigne parmi eux un ou plusieurs membres agréés qui sont dès lors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus à exercer les fonctions de membre agréé représentant le constructeur ou l’employeur que leur confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (16). |
paragraphe (17) |
|
Remplacement d’un membre agréé (17) En cas de démission ou d’empêchement d’un membre agréé, le constructeur ou l’employeur prend, dans des délais raisonnables, toutes les mesures nécessaires pour que l’exigence énoncée au paragraphe (12) soit remplie. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (17). |
article 7.6.5 paragraphe (17) |
|
Pouvoirs du comité (18) Le comité exerce les fonctions et pouvoirs suivants : a) déterminer les situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs; b) faire des recommandations au constructeur ou à l’employeur et aux travailleurs relativement à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité pour les travailleurs; c) faire des recommandations au constructeur ou à l’employeur et aux travailleurs relativement à la création, au maintien et à la surveillance de programmes, de mesures et de pratiques qui ont trait à la santé ou à la sécurité des travailleurs; d) obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur : (i) la façon dont sont signalés les risques éventuels ou réels que présentent des matériaux, des procédés ou du matériel, (ii) l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans des industries, similaires ou non, et dont le constructeur ou l’employeur a connaissance; e) aux fins de la santé et de la sécurité au travail, obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur la réalisation d’essais sur le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique qui se trouvent dans le lieu de travail ou près de celui-ci; f) donner des conseils sur les essais visés à l’alinéa e) qui sont réalisés dans le lieu de travail ou près de celui-ci et faire assister au début de ces essais un membre désigné représentant les travailleurs, si le membre désigné croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essai et des résultats obtenus. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (18). |
paragraphe (18) alinéa a) alinéa b) alinéa c) alinéa d) sous-alinéa (i) sous-alinéa (ii) alinéa e) alinéa f) |
|
Idem (19) Les membres du comité qui représentent les travailleurs désignent l’un des leurs qui a le droit d’assister au début des essais décrits à l’alinéa (18) f). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (19). |
paragraphe (19) |
Va plus loin !
Regarde l’extrait suivant et explique pourquoi trois lignes sont précédées d’un numéro et deux autres sont précédées d’une lettre. Elles sont toutes à la même hauteur, sous un paragraphe – (2) et (3), respectivement – et donc devraient toutes être des alinéas.
PARTIE II.1
CONSEIL DE LA PRÉVENTION, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PRÉVENTION ET ENTITÉS DÉSIGNÉES
CONSEIL DE LA PRÉVENTION
Conseil de la prévention
22.2 (1) Le ministre crée un conseil appelé Conseil de la prévention en français et Prevention Council en anglais. 2011, chap. 11, par. 8 (1).
Composition
(2) Le Conseil se compose des membres que nomme le ministre et comprend des représentants de chacun des groupes suivants :
1. Les syndicats et les organisations syndicales provinciales.
2. Les employeurs.
3. Les travailleurs non syndiqués, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et les personnes ayant une expertise dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 2011, chap. 11, par. 8 (1).
Idem
(3) Lorsqu’il nomme les membres du Conseil, le ministre veille à ce qui suit :
a) un nombre égal de membres sont nommés pour représenter les groupes indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2);
b) le groupe indiqué à la disposition 3 du paragraphe (2) n’est pas représenté par plus du tiers des membres du Conseil. 2011, chap. 11, par. 8 (1).
Nomination des membres
(4) Le ministre fixe la durée du mandat des membres du Conseil. 2011, chap. 11, par. 8 (1).
Président
(5) Les membres du Conseil choisissent un président parmi eux au plus tard à la date fixée par le ministre; s’ils ne le font pas, le ministre désigne un membre comme président. 2011, chap. 11, par. 8 (1).
Idem
(6) Le paragraphe (5) s’applique lors de la première nomination des membres et, par la suite, à chaque vacance du poste de président. 2011, chap. 11, par. 8 (1).
Fonctions
(7) Le Conseil exerce les fonctions suivantes :
a) conseiller le ministre sur la nomination du directeur général de la prévention;
a) et b) sont des alinéas du paragraphe (3), mais les numéros 1, 2 et 3 sont plutôt une énumération de représentants mentionnés dans le paragraphe (2). Ils ne sont pas des alinéas, car ils ne représentent pas des tâches ou des sous-aspects du paragraphe (2).
Maintenant que tu as fait l’atelier sur les différentes divisions d’un texte de loi, tu es en mesure de répondre aux questions suivantes :
a. Quels sont les titres des paragraphes de la Partie III du texte de loi qui s’intitule: « DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES » ?
23. Devoirs du constructeur, 24. Devoirs du titulaire d’un permis. 25. Devoirs de l’employeur, 25.1 Chaussures, 26. Devoirs supplémentaires de l’employeur, 27. Devoirs du superviseur, 28. Devoirs du travailleur, 29. Devoirs du propriétaire, 30. Devoir du propriétaire d’un chantier, 31. Devoirs des fournisseurs, 32. Devoirs des administrateurs et des dirigeants des personnes morales.
b. Ces paragraphes sont-ils organisés ou regroupés de manière logique ?
- Pas vraiment, car on commence par les devoirs du constructeur, puis on descend vers le travailleur pour ensuite remonter vers les administrateurs. On ne suit pas un ordre hiérarchique ici.
- Il y a une certaine logique en parlant du propriétaire, car les deux paragraphes sur lui se suivent.
- D’autres réponses sont possibles.
c. Y a-t-il des alinéas et des sous-alinéas ? Si oui, quels genres d’informations apportent-ils ?
- Les alinéas apportent des informations qui précisent des aspects nommés dans un paragraphe.
- Les sous-alinéas apportent des informations qui précisent un alinéa.
- D’autres réponses sont possibles.
d. Comment la mise en page du texte rend-elle la lecture plus facile (p. ex., disposition du texte, taille et police des caractères, utilisation de couleurs, titre et intertitres, numérotation de lignes, alinéa, paragraphe, etc.) ?
Définition
Mise en page: façon d’organiser et de placer le contenu d’un texte.
- Les alinéas sont placés en retrait du paragraphe et les sous-alinéas sont encore plus en retrait par rapport aux alinéas. Cette disposition différente permet de les repérer plus facilement.
- Le titre de chaque paragraphe et article est écrit en caractères gras. Ceci permet de mieux distinguer un article et un paragraphe d’un alinéa et un sous-alinéa.
- Le chiffre indiquant un article est toujours de couleur grise et en caractères gras. Ceci permet de repérer un article plus facilement.
- D’autres réponses sont possibles.
Étape 2 : La lecture
2.1 Phrases et mots employés
a. Certaines phrases se ressemblent-elles ? Si oui, quelles sont les conventions d’écriture et les formules d’usage (mots répétés au début ou à la fin, etc.) ?
- Tous les paragraphes introduisent normalement des tâches ou des devoirs: «... veille à ce que: ...» et les alinéas sont souvent des tâches.
- Les articles et les paragraphes commencent souvent avec « l’employeur » ou « le travailleur » et se terminent souvent par: « veille à ce que:...».
- Les alinéas finissent souvent par: « selon ce qui est prescrit ».
b. Quel est le registre de langue employé ?
Fais la pause grammaire sur les registres de langue pour répondre à cette question !
En français, il existe quatre registres de langue parlée et écrite. Chacun de ces registres possède ses propres caractéristiques qui permettent de le différencier des autres. En littérature, différents registres de langue sont souvent employés par l’auteur afin de créer un effet de style, un effet sur le lecteur. À l’oral comme à l’écrit, les registres de langue varient toujours en fonction de la situation de communication.
La situation de communication
La situation de communication comprend l’émetteur, son destinataire, le message qu’il transmet à celui-ci et le contexte de transmission du message. L’analyse de la situation de communication d’un message permet de mieux saisir comment un message est transmis et surtout comment il est interprété par le destinataire ou le récepteur.

Le destinataire est la personne à qui l’émetteur souhaite transmettre son message et le récepteur est le «destinataire accidentel», car il reçoit aussi le message, mais celui-ci ne lui est pas adressé (ex.: un enfant de 10 ans écoutant une émission de télévision visant un public de 16 ans et plus).
| Émetteur | Message | Destinataire (ou récepteur) |
|---|---|---|
|
Qui est-il (profession, âge, origine, etc.) ? À qui s’adresse-t-il ? Pourquoi communique-t-il avec ce destinataire en particulier ? Etc. |
Message explicite (contenu, propos, informations) Message implicite (non dit, éléments audiovisuels, etc.) → |
Qui est-il ? D’où vient-il ? Comment pourrait-t-il être affecté par le message ? Etc. |
| Contexte |
|---|
|
Quand le message a-t-il été transmis ? Quand le message est-il reçu ? Où le message est-il transmis (région, pays) ? Quel moyen est utilisé pour communiquer (livre, magazine, message texte, téléphone, télévision, radio, site internet, en personne, etc.) ? Dans quelles langue et registre de langue le message est-il transmis ? Y a-t-il un contact direct entre l’émetteur et le destinataire ? Y a-t-il des éléments nuisibles à la communication ? |
Exercice
Pense à deux situations de communication différentes partageant le même émetteur et le même message à transmettre sur la santé mentale:
- Émetteur: le gouvernement du Canada à travers une compagnie publicitaire
- Message: Il faut parler à quelqu’un si on a des idées noires, car il ou elle peut nous aider à nous en sortir.
Dresse la première situation de communication en fonction d’un destinataire adulte (de 30 ans et plus) et puis une deuxième pour un destinataire enfant (de 8 à 13 ans). En quoi le message pourrait-il être différent ?
Lorsque tu as fini, clique pour voir des exemples de réponses.
| Destinaire: adulte (30 ans +) | Destinataire: Enfant (8-13 ans) |
|---|---|
|
Troubles d’anxiété ? Soucis pendant la nuit ? Problèmes avec la motivation ? Vous n’êtes pas seul. Parlez-en avec votre docteur ou un ami de confiance. Nous avons tous des moments de difficulté, mais il y a de l’aide pour s’en sortir. |
Parfois nous sommes heureux et parfois nous sommes tristes. Si tu es triste trop souvent et que tu as des pensées noires, parles-en avec tes parents ou un autre ami qui peut t’aider. Comme ça tu peux avoir plus de journées heureuses. |
Les quatre registres de langue
Les quatre registres du français sont : le français populaire, le français familier, le français standard et le français soutenu.
| Français | |||
|---|---|---|---|
| Populaire | Familier | Standard | Soutenu |
|
«avoir du front tout le tour de la tête» |
se croire supérieur.e |
effronterie |
outrecuidance |
|
«gosser» |
emmerder |
déranger |
importuner |
|
«carotter» (en verlan) |
chaparder, piquer |
voler |
dérober |
Réécris les phrases ci-dessous dans le registre demandé. Ensuite vérifie tes réponses.
1. Monique arrive pas à parquer son char.
Français standard:
Monique ne parvient pas à stationner sa voiture.
2. Bastien fut couronné de succès lors de la collation des grades.
Français populaire:
Français populaire: Y ont donné une médaille à Bastien à sa graduation de l’Université de Waterloo. Ils ont donné un médial à Bastien à sa graduation.
3. Le papillon vole très haut dans le ciel.
Français soutenu:
Le papillon friponne aux cieux.
4. J’ai des craintes en ce qui concerne ces insectes.
Français familier:
J’ai peur de ces bibittes-là !
Maintenant que tu as fait la pause grammaire sur les registres de langue, essaie de répondre à la question :
b. Quel est le registre de langue employé dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1 ?
Le registre de langue employé est standard, car :
- tous les mots sont dans le dictionnaire et sont communs (pas populaire).
- il n’y a pas de mots anciens ou recherchés, tous sont connus et courants (pas soutenu).
- il n’y a pas de contractions (t’es) ni d’expressions ou de mots familiers (pas familier).
c. Quelles stratégies utilises-tu pour comprendre les phrases et les mots compliqués dans ce genre de document ?
Cette réponse dépend de chaque personne.
- As-tu recherché certains mots dans le dictionnaire ?
- As-tu deviné le sens de mots en fonction du contexte ?
- As-tu manipulé certaines phrases complexes pour les rendre plus simples ?
- Quelle stratégie de lecture as-tu utilisée ?
Dans un document officiel, il y a toujours des mots techniques qui se rapportent à un domaine ou à une activité en particulier.
Définition
Techniques: qui se rapportent à la pratique ou au domaine d’une activité en particulier. Des exemples de mots techniques liés à la pratique du droit seraient: loi, juge, législation, cour, avocat, juridiction, droit fédéral, droit municipal, etc.
a. Trouve au moins trois mots appartenant au champ lexical de deux activités différentes.
Pour rafraîchir ta mémoire à ce sujet, fais la pause grammaire sur le champ lexical !
Le champ lexical est un ensemble de mots se rapportant à un même thème. Cet ensemble sert à mettre en relief une idée importante, à créer une atmosphère particulière ou même à expliquer davantage sur un sujet.
Par exemple, le champ lexical de la mort inclut les mots : sang, poignard, fusil, malheur, perte, regret, pleurs, incinération, funérailles, etc.
Exercice1. Lis l’extrait suivant tiré du roman de Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses (1782). Le locuteur décrit ici une conquête amoureuse et utilise un certain champ lexical pour ce faire. Trouve de quel champ lexical il s’agit et souligne tous les mots qui s’y rapportent.
« Ce n’est donc pas, comme dans mes autres aventures, une simple capitulation plus ou moins avantageuse, et dont il est plus facile de profiter que de s’enorgueillir ; c’est une victoire complète, achetée par une campagne pénible, et décidée par de savantes manœuvres. Il n’est donc pas surprenant que ce succès, dû à moi seul, m’en devienne plus précieux ; et le surcroît de plaisir que j’ai éprouvé dans mon triomphe, et que je ressens encore, n’est que la douce impression du sentiment de la gloire. »
Champ lexical : Niveau soutenu
Mots qui s’y rapportent : autres aventures, capitulation, de profiter, une campagne, savantes manœuvres, dû le surcroît, impression, la gloire.
2. Explique à quoi sert ce champ lexical (quel est son effet sur le lecteur).
Le locuteur parle de ses activités sexuelles comme un défi de manière assez grossière. Mais en utilisant le niveau soutenu, cela devient plus amusant et moins offensif.
Les jeux lexicaux
Un jeu lexical est un jeu de mots où on donne une signification nouvelle et surprenante à un mot ou à une expression. On peut créer un nouveau sens avec les mots:
- en les déformant,
- en les inventant,
- en modifiant des expressions connues ou
- en jouant avec leurs sens multiples (polysémie).
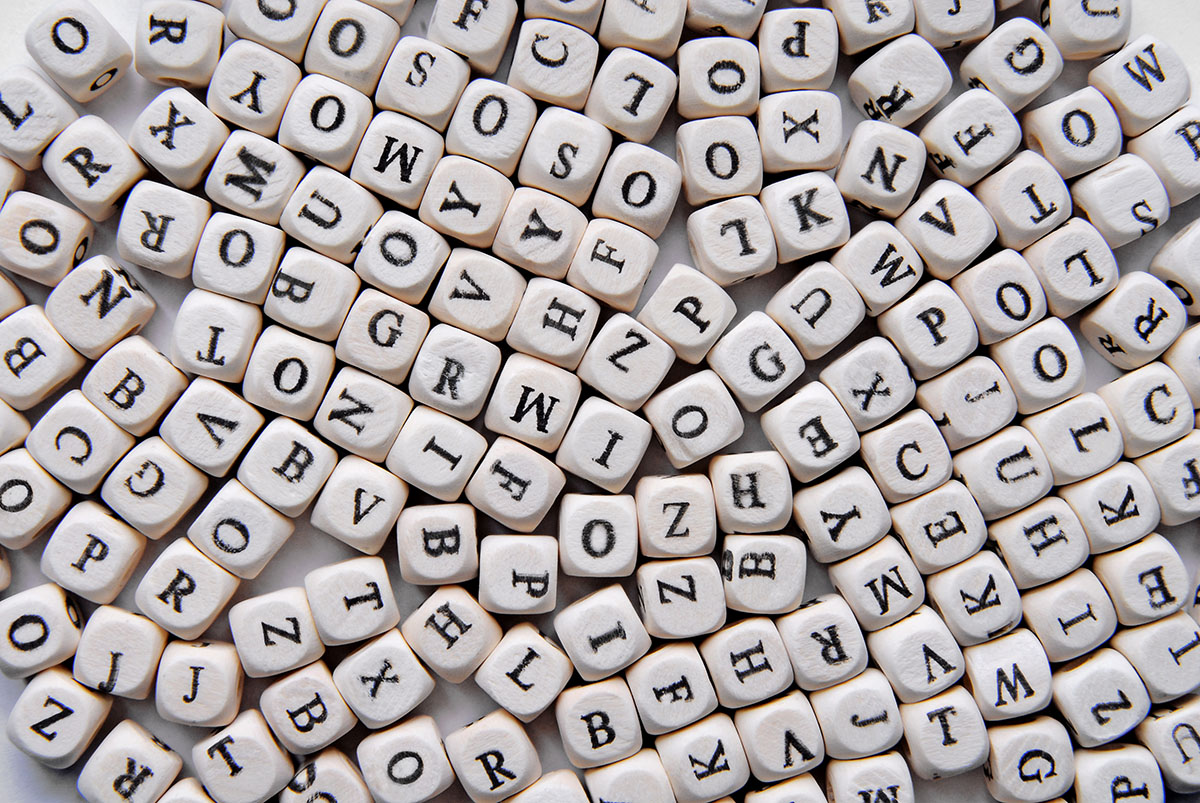
Exercice
C’est à ton tour de trouver les jeux lexicaux dans les extraits suivants des paroles de Loud, le rappeur, et de les expliquer.
- On a pris le bouleau par l'écorce / Tu crois pas qu'on est les GOAT, on s'en bat les cornes»
Il y a plusieurs jeux lexicaux dans cet extrait. Il y a déformation de l’expression connue: « Prendre le taureau par les cornes » où taureau est remplacé par bouleau et les cornes par l’écorce. Le mot bouleau est un homonyme du mot boulot (travail) qui est en lien avec l’expression qui veut dire faire face aux difficultés, donc travailler fort. Puis, l’expression connue est rappelée dans le deuxième vers avec les cornes des « chèvres » (GOAT). Ce mot aussi prend ici deux sens: celui de l’animal et celui de la « meilleure personne de tous les temps ». Une deuxième expression connue est aussi déformée: « on s’en bat les couilles ». Ces deux vers veulent dire qu’ils ont travaillé fort et font face aux difficultés et que si les gens ne croient pas qu’ils soient les meilleurs ils s’en fichent complètement.
- « La médecine fait des miracles, ma tenue peut en témoigner / Hier elle était malade, demain elle sera soignée »
De malade à soignée en une journée, j'ai l'habileté de changer ma tenue facilement et avec aise.
- « Des plaques plein le corridor /, Mais parle moi pas d'art, only Godard can
judge me dawg »
seulement Dieu peut le juger, Godard est un influence artistique
Maintenant que tu as fait la pause grammaire sur le champ lexical reviens à la question posée :
a. Trouve au moins trois mots appartenant au champ lexical de deux activités différentes.
Le champ lexical de la construction: chantier, préavis, matériaux, appareils de protection, bâtiment, structure, charge, ingénierie.
Le champ lexical de l’industrie du spectacle: chaussures à talon haut, publicité, radiodiffusion, représentation devant public, télédiffusion, enregistrement visuel, opéra, concert, cirque, etc.
Il y a beaucoup d’autres champs lexicaux possibles !
2.3 Informations spécifiques
Fais comme si tu révisais pour un examen de droit qui porte sur la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario avec un ami. Pour l’aider à réviser, tu lui poses des questions sur de la matière importante.
a. Parcours le document et trouve trois (3) informations spécifiques que tu trouves intéressantes et dont chacune se trouve dans une partie différente.
Information spécifique 1 :
Partie III, article 27, paragraphe (1)
Information spécifique 2 :
Partie III.0.1, article 32.0.4
Information spécifique 3 :
Partie IV, article 37, paragraphe (1)
b. Formule des questions précises auxquelles ton ami.e devra répondre en trouvant les informations que tu as soulevées dans a. Prépare les réponses dans tes mots au-dessous de chaque question.
Question et réponse 1 :
Question: Quels sont les devoirs d’un superviseur envers le travailleur ?
Réponse: Un superviseur doit s’assurer que le travailleur porte les appareils de protection nécessaires (casques, bottes, etc.) et qu’il respecte les règles de sécurité. Il doit aussi utiliser les appareils de protection exigés par la loi.
Question et réponse 2 :
Question: Que doit faire l’employeur par rapport à la violence familiale au travail ?
Réponse: Si l’employeur croit que de la violence familiale risque de se produire envers un employé au travail, il doit prendre les mesures nécessaires pour le protéger.
Question et réponse 3 :
Question: Que doit faire l’employeur par rapport aux matériaux dangereux, leur identification et les feuilles de données ?
Réponse: L’employeur doit s’assurer que les matériaux dangereux dans le milieu de travail sont tous identifiés comme étant interdits, il doit rédiger une fiche de données sur chacun d’entre eux et s’assurer que l’identification soit disponible en anglais et d’autres langues.
Étape 3 : La post-lecture
3.1 Qu’est-ce qui est important ?
Quels sont les éléments les plus importants à retenir du texte que tu viens de lire ?
Cette réponse dépend de toi !
3.2 Pourquoi a-t-on écrit ce texte ?
Imagine un problème de santé et de sécurité (accidents, etc.) ayant lieu dans un milieu de travail de ton choix. Cette situation-problème doit être réaliste et directement liée au projet de loi que tu viens de lire.
Fais un lien entre le texte de loi que tu as lu et ton problème en citant entre parenthèses l’information sur laquelle tu te bases (ex.: Partie I, article 25, paragraphe (2), alinéa b)).
Ex.: Un employeur d’un laboratoire scientifique a identifié en français tous les matériaux dangereux présents dans son laboratoire comme étant prescrit. Il embauche deux nouveaux employés qui parlent l’anglais, le mandarin et l’espagnol, mais pas le français. Il doit, pour assurer la sécurité de ses nouveaux employés, ajouter une identification en anglais pour tous les produits dangereux. (Partie IV, article 37, paragraphe (1))
Va plus loin !
Si la santé et la sécurité au travail t’intéresse, explore le lien suivant où tu trouveras les divers dangers spécifiques liés à quelques professions en Ontario : Conformité en matière de santé et de sécurité(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre).
Partie 2 : Lecture et analyse d’un code de conduite
Pour cette deuxième et dernière partie de l’activité, tu pourras choisir un autre document officiel parmi les suivants. Il s’agit de codes de déontologie ou codes de conduite. En voici quelques-uns des métiers en Ontario. Explore-les et choisis-en un qui t’intéresse ! Ceci pourra t’être utile pour la prochaine activité où tu devras simuler une situation de travail.
Définition
Déontologie: les devoirs et les obligations à respecter au travail.
Conduite: l’attitude ou la façon d’agir et de se comporter.
Tu peux lire et analyser ces codes en consultant les fichiers joints ou les versions numériques disponibles en ligne.
- Services correctionnels de l'Ontario : Code de conduite et de déontologie – fichier – lien(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre)
- Barreau de l’Ontario (avocat) : Code de déontologie – fichier – lien(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre)
- Services de police: Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15 – fichier – lien(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre)
- L’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario: Code de déontologie – fichier – lien(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre)
- L’Ordre des infirmiers et infirmières de l’Ontario : La déontologie infirmière – fichier – lien(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre)
- Les normes d’emploi (général) : Loi de 2000 sur les normes d'emploi, L.O. 2000,
chap. 41 – fichier – lien(Ouvrir dans une nouvelle fenêtre)
Lis et analyse le code de conduite ou de déontologie de ton choix. Parcours les mêmes étapes que pour la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario.
Étape 1 : La prélecture
1.1 Questions préparatoires
a. Mon but : Pourquoi je fais cette lecture ?
b. Mon intention : Qu’est-ce que je veux faire ?
c. Mes connaissances : Qu’est-ce que je connais déjà sur le sujet ?
1.2 Le survol du texte
Tout d’abord, copie-colle le lien de ton document ici, le cas échéant :
Quels renseignements me sont donnés en regardant uniquement la table des matières ?
a. Quel est le titre du document ?
b. Quels sont les titres des différentes parties du texte ?
c. Comment les différentes parties sont-elles organisées ou regroupées ? Sont-elles placées en ordre logique ?
d. Y a-t-il des outils de navigation (onglets, hyperliens) ?
1.3 Le survol d’une partie du texte
Lis en diagonale une des parties du code que tu as choisi. Écris le titre de cette partie ci-dessous:
Avant de survoler cette partie, tu peux revoir l’Atelier : Les différentes divisions d’un texte de loi.
a. Quels sont les titres des sous-parties de cette partie ?
b. Ces sous-parties sont-elles organisées ou regroupées de manière logique ?
c. Y a-t-il des paragraphes, des alinéas ou des sous-alinéas ? Si oui, quels genres d’informations apportent-ils ?
d. Comment la mise en page du texte rend-elle la lecture plus facile (p. ex., disposition du texte, taille et police des caractères, utilisation de couleurs, titre et intertitres, numérotation de lignes, alinéa, paragraphe, etc.) ?
Étape 2 : La lecture
2.1 Phrases et mots employés
a. Certaines phrases se ressemblent-elles ? Si oui, quelles sont les conventions d’écriture et les formules d’usage (mots répétés au début ou à la fin, etc.) ?
b. Quel est le registre de langue employé ? Justifie ta réponse.
Tu peux refaire la Pause grammaire : les registres de langue pour répondre à cette question !
c. Quelles stratégies utilises-tu pour comprendre les phrases et les mots compliqués dans ce genre de document ?
2.2 Mots techniques
Comme tu le sais déjà, dans un document officiel, il y a toujours des mots techniques qui se rapportent à un domaine ou à une activité en particulier.
a. Trouve au moins trois mots appartenant au champ lexical de deux activités différentes.
Pour rafraîchir ta mémoire à ce sujet, tu peux faire de nouveau la Pause grammaire : le champ lexical !
Champ lexical 1 :
Champ lexical 2 :
2.3 Informations spécifiques
Fais comme si tu révisais avec un(e) ami(e) pour un examen de droit qui porte sur le code déontologique ou de conduite que tu as choisi. Pour l’aider à réviser, tu lui poses des questions sur de la matière importante.
a. Parcours le document et trouve trois (3) informations spécifiques que tu trouves intéressantes et dont chacune se trouve dans une partie différente.
b. Formule des questions précises auxquelles ton ami.e devra répondre en trouvant les informations que tu as soulevées dans a. Prépare les réponses dans tes mots au-dessous de chaque question.
Étape 3 : La post-lecture
3.1 Qu’est-ce qui est important ?
Nomme deux éléments que tu trouves importants dans le code que tu viens de lire et explique pourquoi ils sont importants.
3.2 Pourquoi a-t-on écrit ce texte ?
En te basant sur le code de déontologie ou de conduite que tu viens de lire, imagine une situation réaliste où un problème d’éthique se pose à un travailleur ou une travailleuse.
Ce problème doit avoir lieu dans un milieu de travail précis (ex.: commissariat de police, école, clinique de physiothérapie, etc.).
Fais un lien entre le code de déontologie ou de conduite que tu as lu et ton problème en citant entre parenthèses la partie précise sur laquelle tu te bases (ex.: (Partie I, article 25, paragraphe (2), alinéa b)).
Évaluation : de ses paires: rétroaction
Lecture et analyse d’un code de conduite ou déontologique
Ceci est une évaluation en tant qu' apprentissage et pas pour une note. Tu vas demander à un ami de confiance (ou toi même) d'évaluer tes réponses. Le fait d'étudier en ligne sous forme autonome exige parfois le soutien moral de ses amis. En partageant, tes efforts avec les autres (ceux qui veulent ton bien-être et succès) te les mettent au courant de tes efforts et ta croissance personnelle.
Refais tes réponses aux questions 3.1 et 3.2 de l'Étape 3, sous la forme d'une entrée de journal !
- Ta réponse doit être en lien avec la ou les question(s) posée(s) et cette activité d’apprentissage.
- Tu dois communiquer en français uniquement et rédiger des phrases cohérentes et claires.
- Ton entrée de journal doit contenir entre 50 et 100 mots.
Autoévaluation et réflexion
Ceci est une activité, qui t’aidera à :
- évaluer ton travail;
- déterminer comment tu progresses dans ton apprentissage, ce qu’il te reste à accomplir et la manière d’y parvenir;
- démontrer et préparer ton apprentissage pour l’examen final.
En tant qu’évaluateur ou évaluatrice, tu fourniras une rétroaction en utilisant la grille d’autoévaluation ci-dessous.
Une fois l’étape de la grille d’autoévaluation terminée, pose-toi les questions de réflexion suivantes :
- Je dois améliorer ma compréhension de certains concepts : Quels sont-ils ?
- Quels sont mes points forts ?
- Quelles sont les mesures à prendre pour garantir une bonne compréhension de tous les concepts ?
- Quelles mesures devrais-je prendre pour m’améliorer et m’épanouir en tant qu’étudiant ou étudiante ?
Grille d’autoévaluation
Félicitations ! Tu es maintenant capable de lire et de comprendre un texte de loi ! Ce n’est pas facile, donc tu as fait un bon travail ! Maintenant, tu es prêt à lire d’autres textes du même genre lors d’une activité future. Ces textes-là seront en lien avec le monde de la consommation !
Journal
Réfléchis sur ton apprentissage à travers ton écriture dans ton journal.
- Qu’as-tu appris au sujet des règles de déontologie d’un métier dans cette activité ?
- Quels défis as-tu surmontés en analysant ces documents officiels ?
- Quelles habitudes de travail ou stratégies d’apprentissage as-tu utilisées afin de compléter cette activité ? Explique pourquoi.



